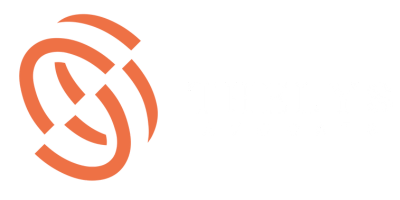La nouvelle directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux : un bouleversement du cadre juridique
Après plusieurs années de travaux, la directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 a été adoptée pour moderniser en profondeur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 18 novembre 2024, elle abroge la directive 85/374/CEE, en vigueur depuis 1985, et devra être transposée dans les législations nationales d’ici le 9 décembre 2026.
Cette directive vise à renforcer la protection des consommateurs tout en prenant en compte les mutations technologiques et économiques. Elle introduit notamment une extension du champ d’application de la responsabilité, un assouplissement des règles de preuve et une adaptation aux nouvelles réalités numériques et industrielles.

Une Extension du champ d'application de la responsabilité
L’une des avancées majeures de la directive est l’élargissement de la définition des produits et des acteurs responsables :
- Intégration des produits numériques et des logiciels : Contrairement à l’ancienne directive qui se limitait aux biens corporels, la nouvelle réglementation inclut désormais les fichiers de fabrication numérique et les logiciels, y compris ceux intégrés dans des dispositifs médicaux ou interconnectés avec d’autres produits. Cette évolution répond à l’essor des objets connectés et de l’intelligence artificielle, dont les dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences graves.
- Responsabilité des plateformes en ligne : Les places de marché numériques pourront être tenues responsables lorsqu’elles jouent un rôle actif dans la commercialisation de produits défectueux, par exemple en contrôlant la présentation ou la logistique de ces derniers.
- Prise en compte des modifications substantielles : Lorsqu’un produit est réparé, reconditionné ou mis à jour en dehors du contrôle du fabricant d’origine, l’entreprise ayant effectué ces modifications pourra être tenue responsable en cas de défectuosité.
- Engagement des importateurs et mandataires : Dans le cadre de la mondialisation, la directive impose désormais que les entreprises ayant mis un produit sur le marché européen soient identifiables et responsables, même lorsque le fabricant est établi hors de l’Union européenne.
Un renforcement des droits des consommateurs
La directive 2024/2853 a été pensée pour faciliter l’indemnisation des consommateur lésés et lever certains obstacles procéduraux :
- Allègement de la charge de la preuve : Jusqu’à présent, les consommateurs lésés devaient prouver la défectuosité du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre les deux. La nouvelle directive allège ce fardeau en instaurant une présomption de défectuosité ou de lien de causalité lorsqu’il existe des difficultés excessives à démontrer ces éléments, notamment pour les produits complexes comme les médicaments, dispositifs médicaux ou systèmes d’intelligence artificielle.
- Divulgation forcée des preuves : Inspirée du système de « discovery » américain, la directive permet au juge d’ordonner au fabricant ou au responsable économique la communication des documents pertinents, notamment en cas d’opacité technologique.
- Reconnaissance des dommages psychologiques : Désormais, les consommateurs lésés pourront être indemnisées pour des atteintes médicalement reconnues à la santé psychologique, comme le préjudice d’anxiété causé par l’exposition à un produit dangereux.
- Indemnisation de la perte de données personnelles : Une avancée notable est la prise en compte des pertes immatérielles. La directive prévoit que la destruction ou corruption de données personnelles stockées sur un appareil défectueux (ex. : photos perdues sur un smartphone en raison d’un défaut technique) pourra ouvrir droit à réparation.
- Allongement des délais de prescription : Le délai de forclusion pour engager une action passe de 10 ans à 25 ans pour les dommages corporels latents, afin de mieux protéger les consommateurs lésés de maladies à développement lent causées par certains produits, notamment pharmaceutiques.
Transposition en droit français
- La transposition de cette directive en droit français soulève plusieurs questions complexes. En particulier, elle devra être conciliée avec le régime actuel de responsabilité civile prévue par les articles 1245 et suivants du code civil, qui repose historiquement sur une logique d’indemnisation intégrale des consommateur lésés.
- De plus, les nouvelles règles relatives à la charge de la preuve et à l’élargissement du champ des responsables marquent un net changement de paradigme qui nécessitera des ajustements procéduraux et réglementaires. Il sera essentiel d’assurer une harmonisation efficace afin d’éviter des conflits entre les règles nationales et le nouveau cadre européen.