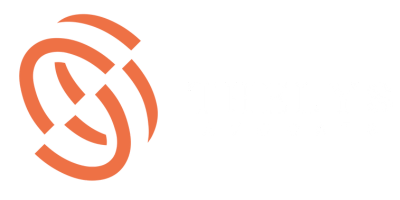La perte du libre arbitre face à l’intelligence artificielle : Perspectives de Gaspard Koenig et Alain Supiot
L’essor de l’intelligence artificielle soulève des interrogations fondamentales. Face à cet outil élevé au rang sachant omniscient, de nombreuses questions techniques et juridiques se posent ; d’autres , fondamentales, viennent bousculer la définition même de notre humanité. Quel sera l’avenir de notre libre arbitre face à l’IA ?
Cette note essaie d’aborder cette question à travers les analyses développées par Gaspard Koenig et Alain Supiot dans leurs livres La fin de l’individu, voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence artificielle (Gaspard Koenig éditions Alpha essai) et la Gouvernance par les nombres (Alain Supiot édition Pluriel)
Koenig, philosophe d’inspiration libérale, s’inquiète principalement de l’érosion de l’autonomie individuelle face aux systèmes prédictifs, tandis que Supiot, juriste spécialiste du droit social, analyse la transformation des systèmes normatifs par ce qu’il nomme « la gouvernance par les nombres ».
Leurs réflexions complémentaires éclairent les multiples enjeux juridiques et techniques liés à cette potentielle perte de libre arbitre à l’ère numérique et de l’intelligence artificielle.
La critique philosophique de l'IA selon Gaspard Koenig
La revendication d'autonomie face aux algorithmes
Gaspard Koenig développe une critique philosophique des systèmes algorithmiques qui menacent l’autonomie individuelle.
Pour lui, la capacité à faire des choix libres et éclairés constitue le fondement même de notre humanité et de notre dignité.
Dans son ouvrage « La fin de l’individu », il analyse comment les algorithmes d’intelligence artificielle, en prédisant nos comportements et en orientant nos choix, érodent cette capacité fondamentale.
Koenig s’inquiète particulièrement du phénomène de « prophétie auto-réalisatrice » engendré par les algorithmes prédictifs : à force de se voir proposer des contenus correspondant à nos habitudes passées, nous risquons de nous enfermer dans des comportements prévisibles, renforçant ainsi le pouvoir prédictif des algorithmes.
Il estime que cette prévisibilité croissante de nos comportements menace directement notre capacité à exercer un libre arbitre authentique, qui suppose une forme d’imprévisibilité et de spontanéité.
La liberté implique la possibilité de surprendre, y compris de se surprendre soi-même, la possibilité de commettre des erreurs et d’apprendre de ces dernières.
Face à ces risques, Gaspard Koenig ne se contente pas d’une critique : il propose des pistes pour préserver et renforcer le libre arbitre à l’ère numérique.
L’une de ses propositions centrales concerne la propriété des données personnelles, qu’il considère comme un prolongement de notre personne et de notre autonomie.
En reconnaissant aux individus un véritable droit de propriété sur leurs données, Koenig estime qu’on leur redonnerait le pouvoir de négocier les conditions de leur utilisation par les systèmes d’IA.
Le philosophe plaide également pour une « écologie de l’attention », c’est-à-dire une prise de conscience et une protection active de nos capacités attentionnelles face aux stratégies de captation mises en œuvre par les algorithmes.
Il souligne l’importance de l’éducation critique au numérique, qui permettrait aux citoyens de comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière les interfaces et de développer une forme de « réflexivité numérique » : la capacité à prendre conscience des influences algorithmiques pour mieux s’en émanciper.
La gouvernance par les nombres : la critique d'Alain Supiot
La technique juridique face à la gouvernance algorithmique
Alain Supiot offre une perspective juridique et sociologique complémentaire à l’approche philosophique de Koenig.
l’émergence de l’IA s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des modes de régulation sociale, où la norme juridique traditionnelle, fondée sur l’interprétation et le jugement humain, cède progressivement la place à une régulation par les chiffres et les algorithmes.
Cette évolution transforme profondément la nature même du droit et son rapport à la liberté humaine.
Dans son ouvrage passionnant « La gouvernance par les nombres« , Supiot montre comment le droit, en tant que technique de coordination des actions humaines, se trouve progressivement colonisé par une autre technique, celle du calcul algorithmique.
Cette substitution n’est pas sans conséquence : alors que le droit traditionnel préserve des espaces d’interprétation et reconnaît la singularité des situations, l’algorithme tend à standardiser et à quantifier.
Il existe dans le droit une poétique intrinsèquement liée à la matière humaine. Le droit est une science sociale et non un monstre froid.
La déshumanisation par la quantification et la standardisation
Au cœur de la critique de Supiot se trouve le processus de quantification systématique qui caractérise la gouvernance algorithmique.
Cette quantification conduit à une forme de déshumanisation, en réduisant la complexité des situations humaines à des variables mesurables et calculables. L’IA, en tant qu’instrument privilégié de cette gouvernance par les nombres, participe activement à ce processus.
En transformant les relations sociales en transactions quantifiables et les qualités en quantités, elle contribue à ce que Supiot nomme le « totalitarisme inversé » : non plus l’assujettissement des individus à un pouvoir central visible, mais leur soumission à un système technique diffus et omniprésent.
Pour Supiot, cette évolution menace directement le libre arbitre, non pas tant en contraignant directement les individus qu’en modifiant les conditions mêmes dans lesquelles ils peuvent exercer leur autonomie.
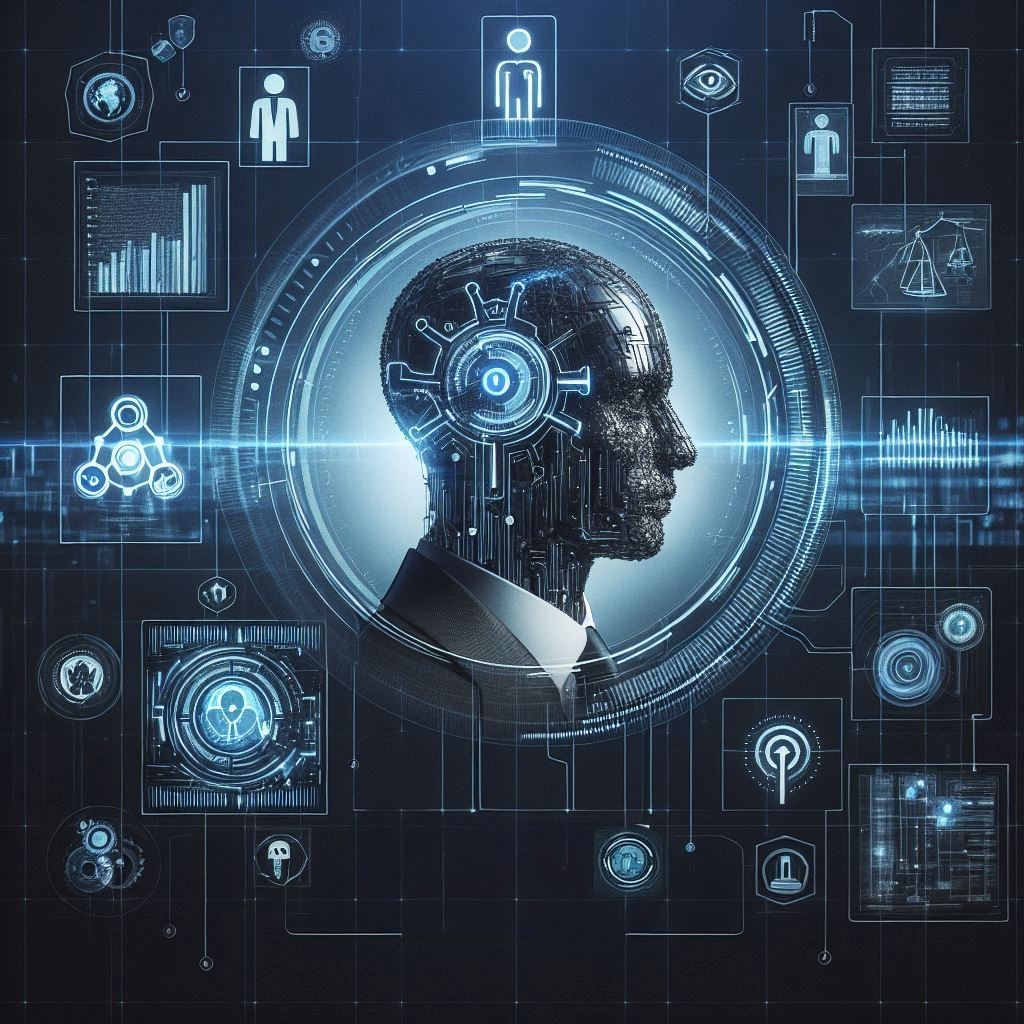
La défense de la dignité humaine contre l'aliénation technique
Face à ces évolutions, Supiot développe une défense de la dignité humaine qui passe par la réaffirmation de la primauté du droit sur la technique.
Pour lui, le droit ne doit pas être réduit à un simple instrument technique parmi d’autres, mais doit conserver sa fonction anthropologique fondamentale : garantir les conditions d’une vie humaine digne dans un monde habitable.
Le droit est une matière vivante ; c’est une matière du vivant.
Cette conception du droit implique une résistance active à la réduction de l’humain à ses dimensions calculables.
La défense du libre arbitre passe alors par la préservation d’espaces juridiques où la singularité des personnes et des situations est reconnue et protégée contre l’homogénéisation algorithmique.
La gouvernance par les nombres : la critique d'Alain Supiot
Convergences dans la critique de la technicisation
Malgré leurs différences d’approche, Koenig et Supiot convergent dans leur critique de la technicisation croissante des rapports humains sous l’influence de l’IA.
Supiot compare les juges automates à des exécutants d’un système cybernétique, où la décision juridique devient une réaction programmée plutôt qu’un acte de liberté.
Dans la fin de l’individu, Koenig utilise la métaphore du « siNge turc » – référence à l’automate du XVIII siècle qui simulait l’intelligence humaine et dénonce l’illusion d’autonomie de l’intelligence artificielle.
Tous deux s’inquiètent de la façon dont les techniques algorithmiques tendent à se substituer au jugement humain dans des domaines toujours plus nombreux, conduisant à une forme d’aliénation.
Ils partagent également une préoccupation pour la préservation d’une forme d’opacité ou d’imprévisibilité humaine face à la transparence calculatoire visée par les systèmes prédictifs.
Cette imprévisibilité, loin d’être un défaut à corriger, constitue selon eux une condition même de la liberté : être libre, c’est pouvoir surprendre, c’est ne pas être entièrement prévisible.
Enfin, ils s’accordent sur le fait que la régulation de l’IA ne peut se limiter à des considérations techniques ou économiques, mais doit intégrer des dimensions éthiques, juridiques et philosophiques pour préserver les conditions d’exercice du libre arbitre face aux systèmes automatisés.
Vers une régulation éthique et juridique de l'IA
Les réflexions de Koenig et Supiot ouvrent des pistes précieuses pour penser une régulation de l’IA qui préserverait les conditions d’exercice du libre arbitre. Une telle régulation devrait, selon leurs analyses croisées, combiner plusieurs dimensions.
D’abord, une dimension proprement juridique, avec l’élaboration de cadres normatifs limitant le champ d’application des décisions automatisées et garantissant un droit effectif à l’explication des décisions algorithmiques.
Les réflexions de Koenig et Supiot trouvent un écho particulier dans l’élaboration actuelle de cadres réglementaires visant à encadrer l’IA.
Ensuite, une dimension technique, avec le développement de méthodes de conception d’IA respectueuses du libre arbitre (privacy by design, ethics by design). Cette régulation multidimensionnelle ne pourrait être uniquement nationale mais devrait s’inscrire dans des cadres internationaux, tant les enjeux dépassent les frontières traditionnelles.
Enfin, une dimension éthique, avec la formulation de principes directeurs guidant le développement et le déploiement des systèmes d’IA, comme la transparence, la loyauté ou la préservation de l’autonomie humaine.
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, édition Pluriel
Gaspard Koenig, la fin de l’individu, voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence artificielle, éditions Alpha essai